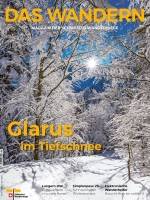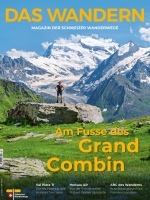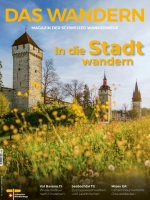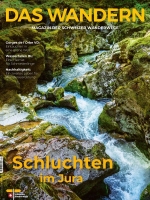Le brame du cerf dans le Val Mingèr
Le Parc national suisse compte deux régions dans lesquelles on peut observer le roi des forêts. La plus célèbre est le Val Trupchun, facile à atteindre depuis S-chanf. Et la plus belle est le Val Mingèr, une haute vallée retirée au fond de l’Engadine. De mi-septembre à mi-octobre, les chances sont bonnes d’assister au rut du cerf, ou du moins d’entendre son brame. Et si ce n’est pas le cas, le paysage naturel intact avec ses forêts de pins, ses torrents de montagne et ses pics rocheux sauvages offre une belle consolation. De fin mai à mi-octobre, un car postal grimpe de la station thermale de Scuol dans le Val S-charl jusqu’à la bifurcation avec le Val Mingèr, ce qui évite de longs kilomètres de marche sur la route. A l’arrêt, le panneau indique «Sur Il Foss», un but intermédiaire de ce parcours. Le chemin de randonnée quitte la route et longe le cours d’eau dans le Parc national. En automne, dans les forêts de mélèzes et de pins du fond de la vallée et sur les versants du Piz Mingèr et du Piz dals Cotschens, les cerfs font bruyamment la cour aux biches. Il y aurait peut-être de meilleurs postes d’observation mais on ne peut pas quitter les sentiers dans le Parc national. Quant aux pique-niques, ils ne sont autorisés que sur les aires de repos prévues à cet effet. De plus, les chiens sont interdits d’accès. Le chemin s’élève constamment jusqu’au col de Sur il Foss, à 2316 mètres. C’est aussi la limite du parc. Derrière s’ouvre une autre magnifique vallée, le Val Plavna, où, contrairement au Val Mingèr, l’économie alpestre est présente. En suivant l’indicateur en direction de Tarasp Fontana, le chemin de randonnée passe devant l’Alp Plavna et redescend dans la vallée principale de l’Engadine. Un car postal relie Tarasp Fontana à Scuol.
La basse sonore des cerfs adultes qui brament ne résonne presque plus dans le Val Mingèr et seuls des yeux avertis aperçoivent quelques biches paissant sur les pentes ensoleillées du Piz dals Cotschens. La neige précoce a poussé les cerfs vers de plus basses altitudes début octobre déjà. Annina Buchli a donc plus de temps pour parler de la fascination qu’exercent ces animaux lors de la randonnée à travers le Parc national suisse, des combats et des rituels d’accouplement, de l’extermination et de la surpopulation, des mythes et des nouvelles connaissances.
C’est la cinquième saison d’Annina Buchli au Parc national, où elle guide chaque année une trentaine d’excursions en romanche, allemand, anglais, italien et français. Ce jour-là, elle ne se rend pas dans le Val Trupchun, où des centaines de personnes attendent parfois sur les lieux de repos pendant la période du brame, mais nous mène dans le Val Mingèr, une haute vallée au paysage fascinant située entre Scuol et l’Ofenpass. C’est l’un des quartiers d’été des cerfs. Ils y montent au printemps, quand la neige fond lentement et que l’herbe se met à pousser. En automne, ils parcourent les nombreux kilomètres qui les séparent de leurs zones hivernales dans la vallée principale de l’Engadine ou dans les vallées du sud des Grisons. «Ils sont toujours poussés par la recherche de nourriture et de calme», explique Annina Buchli pour justifier ces longues migrations.
Le mâle dominant
Entre ces déplacements géographiques a lieu la période du rut, qui fascine tant de gens et qui a fait du cerf un symbole de force et de puissance. Elle commence vers le 10 septembre et atteint son apogée à la fin du mois. Dès que les biches ovulent et commencent à dégager une odeur irrésistible pour les cerfs adultes, rien ne peut arrêter les mâles. Ils ont vécu entre eux tout l’été et cherchent alors inexorablement à se rapprocher des femelles. En bramant bruyamment, ils tentent d’impressionner les femelles et en même temps de dissuader les rivaux. La plupart du temps, cela fonctionne bien. Mais si un rival ne se laisse pas troubler, des combats éclatent, qui peuvent parfois être mortels pour le vaincu.
Une fois que les mâles adultes ont établi leur hiérarchie, le cerf dominant rejoint toute une harde de biches. La tâche épuisante de l’accouplement ne lui permet guère de se nourrir et il perd donc jusqu’à un tiers de son poids pendant le rut. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, la biche ovule trois semaines plus tard, est à nouveau saillie et met presque certainement bas au printemps suivant. Avec son petit de l’année précédente, elle traverse un nouveau cycle annuel. A l’âge de 2 ans déjà, les jeunes biches peuvent être elles-mêmes gravides.
Traces de défoulement
Le chemin de randonnée traversant le Val Mingèr monte constamment dans des forêts de mélèzes et de pins le long du torrent Ova da Mingèr. Ici, l’eau charrie une telle quantité de sédiments des escarpements environnants que le paysage se transforme sans cesse. Là où le chemin suit encore le très ancien tracé, on voit souvent des endroits sombres où l’on faisait brûler des meules à charbon bien avant la création du Parc national.
Les prairies dans les clairières sont broutées comme sur un alpage, bien que toute exploitation soit interdite dans l’ensemble de la vallée depuis plus de 100 ans. «Ce sont des traces évidentes de cerfs», précise Annina Buchli. Elle montre aussi des arbres écorcés, où les cerfs ont frotté les velours de leurs bois, et des buissons complètement écrasés. «Ici, les mâles se sont probablement défoulés parce qu’ils n’ont pas pu le faire pendant le rut», explique-t-elle.
Pas que du bonheur
Dans le Parc national, les cerfs font ce qu’ils veulent. Avec le bouquetin, l’aigle, le gypaète barbu et peut-être le casse-noix moucheté, l’emblème du parc, ils font partie des stars. Mais hors de la zone protégée, ils causent plus souvent des problèmes. En été, ils se régalent volontiers des champs de maïs à basse altitude, et en hiver, ils consomment tant d’écorces et de jeunes branches que même les forêts protégées peuvent être menacées. Pendant des décennies, les relations entre l’homme et le cerf ont donc été presque aussi tendues que celles qui prévalent aujourd’hui entre l’homme et le loup.
Au XIXe siècle, le cerf était considéré comme exterminé en Suisse. La destruction de son habitat et la chasse intensive avaient eu raison de lui. Dans les années 1860 et 1870, des cerfs furent lâchés dans le Vorarlberg autrichien et finirent par revenir en Engadine. Au XXe siècle surtout, la population augmenta si rapidement que les conflits avec l’agriculture et la sylviculture se multiplièrent et on demanda une plus forte régulation.
Lorsque, dans les années 1960, on assista au début de ce que l’on nomme la mortalité hivernale, on constata qu’une limite naturelle avait été atteinte. Annina Buchli a vu des images de vieux journaux montrant des amoncellements de cerfs morts en hiver par manque de nourriture. Aujourd’hui, on abat 5000 cerfs chaque année dans les Grisons, ce qui maintient la population stable à environ 15 000 bêtes. Même dans le Parc national, les gardiens abattaient encore parfois des cerfs il y a 30 ans, ce qui est désormais considéré comme un péché. Aujourd’hui, les quelque 2000 cerfs du parc vivent à nouveau en toute quiétude.
Un nouveau chasseur
Quoique … Un nouveau chasseur met de plus en plus de pression sur le roi des forêts. En 2023, une meute de loups, dite meute du Fuorn, s’est installée dans la région du Parc national. Bien qu’un cerf adulte aux bois imposants n’ait pas grand-chose à craindre, les jeunes cerfs correspondent parfaitement au schéma de prédation des loups. «Les loups ont une influence sur le comportement des cerfs et sur tout l’écosystème du Parc national», explique Annina Buchli. Selon elle, les migrations des cerfs sont devenues moins prévisibles. «Au lieu de grandes meutes, nous voyons aujourd’hui plutôt des petits groupes.» On suppose que les cerfs réduisent ainsi le risque d’attaques de loups. Et si moins d’animaux broutent le même pâturage, la végétation s’en trouve aussi modifiée. Elle explique qu’aujourd’hui, les prairies de montagne sont parfois plus hautes et on y voit plus de fleurs. L’an dernier, l’Office fédéral de l’environnement a autorisé l’abattage de la meute du Furon, car des loups avaient tué deux veaux ou bovins. Depuis, 14 loups ont été abattus en dehors du Parc national et contre la volonté de ses responsables.
Un plan B
Dans la partie supérieure du Val Mingèr, Annina Buchli fait une pause, sur la seule aire de repos officielle de la vallée. Dans le Parc national, il est interdit de quitter les chemins de randonnée officiels et le pique-nique n’est autorisé que sur les places prévues à cet effet.
Annina Buchli saisit ses jumelles et scrute les versants opposés. Un cerf se prélasse-t-il au soleil sous un arolle noueux? Les jeunes animaux font-ils des réserves juste avant l’hiver? Elle voit de nombreux chamois, mais le grand rassemblement des cerfs en période de rut a déjà eu lieu.
Elle sort alors d’une caisse en aluminium fixée au sol un crâne de cerf avec ses bois. Les organisateurs de l’excursion ont déposé ici du matériel d’illustration, au cas où la nature ne serait pas aussi généreuse qu’espéré. Un bois de cerf à huit cors, même décoloré, doit combler le vide.
Le mythe des bois
Les biches peuvent vivre jusqu’à l’âge de 20 ans. Les mâles, par contre, qui prennent plus de risques et se nourrissent moins, notamment pendant le rut, dépassent rarement les 16 ans. Ils gagnent bel et bien en masse de bois chaque année, mais l’idée que chaque cor représente une année est un mythe, explique Annina Buchli. Les bois à 14 cors sont déjà assez rares, mais il en existe des encore plus puissants. Si l’on pense que les cerfs perdent leurs bois chaque année à la fin de l’hiver et en forment de nouveaux, c’est impressionnant.
Annina Buchli explique où l'on peut voir des cerfs.
En dehors du parc, une partie des bois tombés est ramassée par les chasseurs locaux comme trophées ou pour la vente. Ils savent exactement à partir de quand la chute des bois des cerfs a lieu et se mettent alors en quête. Cette recherche de mues est toutefois indésirable et strictement interdite dans le Parc national, car elle entraîne des perturbations massives pour les animaux. Si un bois n’est pas découvert, il est souvent dévoré par des rongeurs. Même les cerfs eux-mêmes rongent les bois abandonnés.
Tandis qu’Annina Buchli parle du cerf, elle est rapidement entourée par d’autres randonneuses et randonneurs. Le cerf intéresse les gens et la mue est particulièrement fascinante. Certains y voient un symbole de résurrection et attribuent même au cerf quelque chose de divin. Quoi qu’on en pense, le plus grand animal sauvage de Suisse est de toute façon fascinant.

Tipp
Si l’on souhaite en savoir plus sur le contexte et l’histoire du Parc national ou simplement louer des jumelles pour observer les animaux, il est conseillé de se rendre au centre du Parc national à Zernez. Les enfants y trouveront également leur compte.